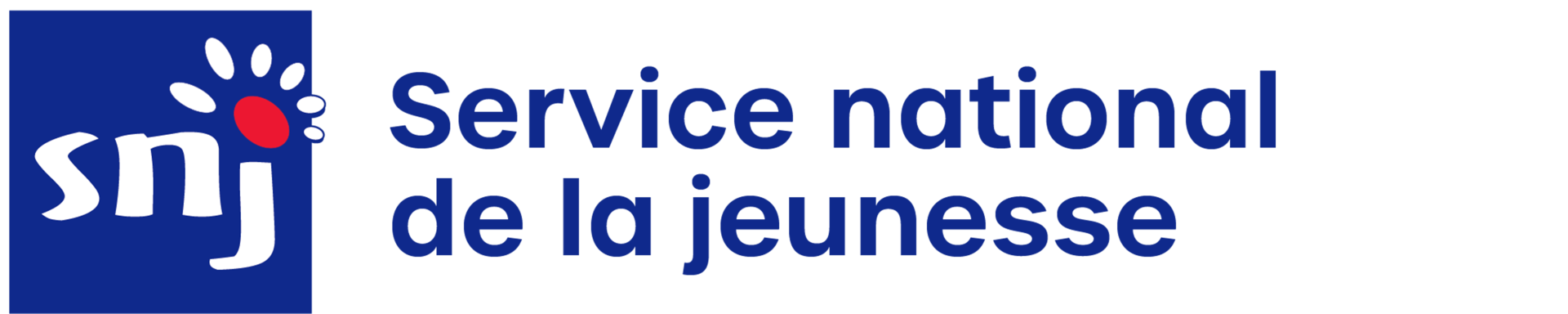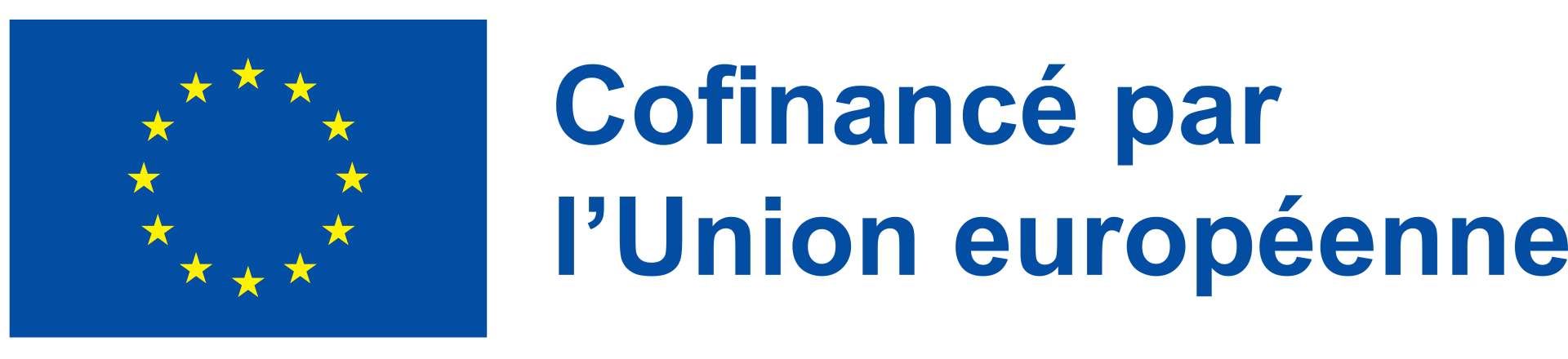Les plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube s’appuient de plus en plus sur des systèmes automatisés pour analyser les contenus publiés. Ce filtrage automatique, censé détecter rapidement les contenus problématiques, peut toutefois entraîner des effets inattendus : certaines publications deviennent invisibles, alors qu’elles sont inoffensives, voire éducatives. Pour contourner cela, de nombreux utilisateurs font preuve de créativité. L’une des stratégies les plus répandues est appelée Algospeak – une forme de langage codé propre aux réseaux sociaux. Mais qu’est-ce que l’Algospeak exactement ? Quels mots et quels emojis sont concernés ? Et comment reconnaître cette forme de communication dans la pratique quotidienne ?
Qu’est-ce que l’Algospeak – et pourquoi est-il utilisé?
L’Algospeak désigne une manière délibérément modifiée de s’exprimer en ligne. Les mots sont altérés, des lettres remplacées par des chiffres ou des symboles (par exemple : « Seggs » au lieu de « Sex ») et certains emojis prennent de nouvelles significations. Le but est simple : faire en sorte que les contenus restent visibles malgré les filtres automatiques.
Ce phénomène est lié au fonctionnement des systèmes de modération des plateformes. Certains mots-clés peuvent déclencher des avertissements ou réduire la portée des publications, y compris lorsqu’elles abordent des sujets sensibles de manière informative – comme la santé mentale, les discriminations ou la sexualité.
C’est pourquoi certains internautes ont recours à des codes – soit pour se protéger, soit pour éviter la censure, soit pour s’exprimer de manière plus créative. Un exemple marquant est la tendance #MascaraTrend sur TikTok : sous prétexte de parler de maquillage, des personnes ont partagé des témoignages sur des violences subies – dans un langage codé, mais compréhensible pour celles et ceux qui savent lire entre les lignes.
Quand un emoji en dit plus que mille mots
L’un des éléments clés de l’Algospeak est l’utilisation intentionnelle d’emojis. Pensés à l’origine pour enrichir la communication visuelle, certains emojis prennent dans certains contextes des sens doubles ou ambigus, parfois à caractère sexuel ou suggestif.
Exemples d’emojis à connotation sexualisée ou détournée :
- 🔥 : « Tu es sexy » – expression de l’attractivité physique
- 💦 : allusion à l’éjaculation
- 🍆 : symbole de l’organe sexuel masculin
- 🍒 : représente les seins féminins
- 👅 : allusion au sexe oral
- 🥒 : représentation alternative à connotation sexuelle
On retrouve ces emojis dans des commentaires, des messages privés ou des stories – seuls ou en combinaison. Selon le contexte, ils peuvent paraître humoristiques, ironiques ou inappropriés. Lorsqu’ils sont associés à des phrases explicites ou des sollicitations, leur usage peut franchir la ligne du harcèlement.
Quand les emojis deviennt des symboles idéologiques
Mais la communication symbolique ne se limite pas à la sexualité. La communication codée ne se limite pas au champ de la sexualité. Dans certaines sous-cultures en ligne – comme la scène dite incel ou red pill – ou encore dans les milieux néonazis, les emojis sont également devenus des symboles identitaires.
Quelques exemples :
- 💯 (cent) : utilisé pour illustrer la soi-disant règle des 80/20, selon laquelle 80 % des femmes ne seraient attirées que par 20 % des hommes. Cette croyance est souvent invoquée pour justifier des discours misogynes.
- 💊 (pilule rouge) : fait référence à la Red Pill du film Matrix, mais elle est aujourd’hui réappropriée dans certains forums pour exprimer une vision antiféministe du monde, opposée aux « normes sociales dominantes ».
- ⚡⚡ (deux éclairs) : fait référence à la double rune sig, symbole de la Schutzstaffel (« SS »).
Important : ces emojis ne posent pas de problème en soi. Tout dépend de leur usage et du contexte. Dans les discussions marquées idéologiquement, ils fonctionnent souvent comme signaux implicites ou moyens d’identification au sein d’un groupe.
Ce que font les plateformes – et ce qui reste flou
Les grandes plateformes ont commencé à réagir. De nombreux termes codés liés à l’Algospeak sont désormais identifiés. Par exemple, une recherche TikTok sur le mot « Sewer Slide » (substitut de « Suicide ») déclenche les mêmes messages de prévention que le terme original.
Grâce aux avancées en intelligence artificielle, les plateformes peuvent également analyser le contexte sémantique d’un message. Il est ainsi possible de différencier une utilisation d’un mot comme « Auschwitz » dans un cadre éducatif ou historique – ou au contraire problématique.
Mais beaucoup de choses restent opaques. Les utilisateurs reçoivent rarement d’explication quand leurs contenus sont moins visibles. Et les critères précis qui régissent ces décisions ne sont ni clairs, ni publics.
Comprendre les codes du numérique
L’Algospeak est un reflet de la culture numérique actuelle – fluide, inventive, mais aussi parfois difficile à décoder. Ce qui commence comme une stratégie de contournement peut aussi servir à dissimuler des contenus problématiques. Et les emojis, loin d’être de simples illustrations, sont devenus des éléments à part entière du langage en ligne.
Pour celles et ceux qui publient, modèrent ou analysent les contenus, il est essentiel de prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux signes et aux intentions. Car le langage numérique dépend toujours du contexte – et mérite une lecture attentive.
Ce guide (en anglais) aide à mieux comprendre l’usage courant des emojis chez les jeunes : https://resources.saferschoolstogether.com/view/294238754/
Ce texte est basé sur un article de notre partenaire klicksafe.de :